Raphaël. La Madone Sixtine (1512-13)
Cliquer sur les images ci-dessus
PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.
Patrick AULNAS
Cette œuvre de Raphaël (1483-1520) a connu le succès bien au-delà du monde de l’histoire de l’art. Les deux petits angelots rêveurs figurant à la base du tableau ont en effet été reproduits des dizaines de millions de fois sur des objets divers (cartes postales, vêtements, accessoires, objets de décoration, etc.). Ils touchent le grand public et font vendre. Mais ce tableau est intéressant pour les historiens à un autre titre : il renouvelle la conception du tableau d’autel.
Raphaël. La Madone Sixtine (1512-13)
Huile sur toile, 269,5 × 201 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.
Image HD sur GOOGLE ARTS & CULTURE
Contexte historique
Après, avoir passé quatre ans à Florence, Raphaël se rend à Rome à la fin de l'année 1508. Il est désormais célèbre et le pape Jules II (1443-1513, pape à partir de 1503) souhaite lui confier la décoration de certaines salles du Vatican. Il réalisera aussi un portrait célèbre du pape.
Le tableau devrait s’appeler La Madone de Saint Sixte mais son appellation la plus connue est La Madone Sixtine. La création de La Madone Sixtine est en relation avec un conflit, dit guerre de la Ligue de Cambrai, mettant aux prises les États pontificaux, la République de Venise et la France. Il dura de 1508 à 1516. Le tableau a été commandé pour servir de retable dans l’église San Sisto (Saint Sixte) de Piacenza. Jules II voulait ainsi remercier la ville de Piacenza pour le soutien apporté dans sa lutte contre la présence française.
Le retable arrive dans l’église San Sisto en 1514 et y reste jusqu’à 1754. Il est vendu cette année-là à Auguste III de Saxe (1696-1763) pour compléter sa collection de Dresde. Une copie du peintre vénitien Giuseppe Nogari (1699-1763) est placée dans l’église San Sisto.
Analyse de l’œuvre
Raphaël place les trois figures sur des nuages, c’est-à-dire « au ciel » pour les contemporains, qui étaient tous sous l’emprise d’une croyance religieuse naïve. Un rideau et une balustrade encadrent la scène pour produire un effet théâtral. Il s’agit d’une apparition de la Vierge, similaire à celle des acteurs d’un théâtre à l’ouverture du rideau. Cette scène religieuse se rattache à la conversation sacrée, thème apparu au 15e siècle : la Vierge et l'Enfant Jésus sont entourés de saints qui semblent bavarder entre eux. Les personnages représentés ne sont pas contemporains l’un de l’autre puisqu’ils se rencontrent post mortem, au paradis. Le donateur ou le commanditaire est parfois représenté, mais pas dans le cas présent. Par contre, la tiare du pape Jules II est visible en bas à gauche.
Raphaël. La Madone Sixtine, détail
La Vierge à l’Enfant est ici accompagnée de saint Sixte et de sainte Barbe. La Vierge apparaît dans les vêtements conventionnels de l’iconographie avec les couleurs rouge et bleue. Le mouvement qui l’anime fait toute l’originalité de la composition. Elle semble surgir de l’arrière-plan, mais avec la douceur et la sérénité caractérisant le divin. Le regard inquiet rappelle le destin tragique du fils qu’elle porte dans ses bras.
Raphaël. La Madone Sixtine, détail
Sixte 1er (v. 42-128) est le septième évêque de Rome, fonction devenue papale à partir du 4e siècle. Après dix années d’épiscopat, il mourut en martyr. Saint Sixte était le patron de la famille Della Rovere d’où était issu le pape Jules II. Pour lui attribuer un rôle d’intercesseur, Raphaël représente Sixte le regard tourné vers la Vierge et le doigt pointé vers les fidèles observant le tableau. Il lui donne un visage proche de celui de Jules II et l’habille d’une cape décorée de feuilles de chêne, élément figurant aussi sur le blason de la famille Della Rovere.
Raphaël. La Madone Sixtine, détail
Selon la tradition chrétienne, Barbe (ou Barbara) aurait vécu au 3e siècle. Elle fut enfermée par son père dans une tour afin de la protéger du prosélytisme des chrétiens. Mais un prêtre pénétra dans la tour et la baptisa. Son père la livra au gouverneur romain et elle fut suppliciée. Comme Saint Sixte, Sainte Barbe était vénérée par la communauté religieuse de San Sisto à Piacenza. Le peintre l’a représentée pieusement agenouillée, les yeux baissés, orientés vers les deux putti du bas du tableau.
Raphaël. La Madone Sixtine, détail
Ces deux angelots apportent une note de spontanéité à une composition picturale orientée vers des figures saintes prenant la pose. Ils observent la scène avec le regard de l’enfance, en se posant des questions. Ils ne sont pas effrayés par l’apparition de la Vierge mais simplement étonnés. Leur regard tourné vers le haut a permis de les utiliser comme un symbole universel de l’enfance confrontée à la découverte du monde des adultes.
Cette conversation sacrée entre trois figures saintes se situe dans une évolution historique du thème au début du 16e siècle. Au 15e siècle, la scène était placée dans un ensemble architectural lui donnant un caractère très solennel. La taille inférieure des saints permettait de marquer la hiérarchie :
Fra Angelico. Retable San Domenico ou Pala di Fiesole (1423-24)
Tempera et or sur bois, 212 × 237 cm, San Domenico, Fiesole.
L’évolution du début du 16e siècle comporte deux aspects. D’une part, la scène est désormais placée en extérieur, dans un paysage. D’autre part, la solennité disparaît, les artistes souhaitant au contraire suggérer une certaine intimité. La distance focale se réduit afin que les personnages apparaissent proches de l’observateur du tableau. Mais de ce fait, ils sont aussi plus proches l’un de l’autre :
Palma Vecchio. Vierge à l’enfant avec saints et donateur (1518-20)
Huile sur bois transféré sur toile, 105 × 136 cm, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.
La Madone Sixtine peut être considérée comme intermédiaire. La composition symétrique subsiste mais un simple rideau remplace la lourde architecture. Le caractère statique disparaît également avec une Vierge debout et semblant apparaître soudainement sur les nuages. Outre ce surgissement de la Vierge, la vue en contreplongée place le fidèle dans un ressenti psychologique correspondant à son éducation religieuse. Le paradis est en effet situé « en haut » et il appartient au croyant de « s’élever » vers Dieu. En remplaçant le retable classique, comportant de multiples figures religieuses statiques dans un ensemble architectural, par une composition dynamique à trois figures, instaurant un véritable appel à rejoindre la divinité, Raphaël bouleverse la conception du tableau d’autel. Cet élan vers les cieux inspirera par la suite de nombreux artistes. En voici, quelques exemples.
Quelques autres compositions religieuses en contreplongée
|
Titien. L'Assomption de la Vierge (1516-18). Huile sur bois, 690 × 360 cm, Église Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise. L'Assomption de la Vierge, ou de Marie, est une légende religieuse selon laquelle la mère du Christ ne serait pas morte à la façon des humains mais aurait rejoint directement le paradis. Titien évoque cette croyance en trois plans. En bas, les apôtres sont sidérés par l'évènement. Au centre, la Vierge s'élève vers les cieux, sur un nuage, accompagnée d'une nuée d'anges. Tout en haut, Dieu l'attend. Considérée comme novatrice à l'époque cette œuvre reste pour les historiens un tournant dans la carrière de Titien. Elle met en évidence l'intensité de l'évènement par les couleurs vives, les contrastes ombre-lumière et l'accentuation des mouvements. En cela, elle préfigure déjà le baroque. Noter la puissance physique des personnages (Dieu, les apôtres), qui dénote une influence de Michel-Ange. |
|
Raphaël. Transfiguration (1518-20). Huile sur bois, 405 × 218 cm, musées du Vatican, Rome. Episode biblique. Le Christ se rend sur le mont Thabor avec ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Il se métamorphose physiquement, révélant ainsi sa nature divine. Selon la Bible, son visage change et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Cette légende est illustrée par la partie supérieure du tableau. La partie inférieure concerne le miracle de l'enfant possédé : l'apparition du Christ libère un jeune garçon d'une possession démoniaque. L'œuvre préfigure le maniérisme par son luminisme (usage de couleurs vives) et l'accentuation des postures des personnages. Le tableau n'a pas été achevé par Raphaël mais probablement par Giulio Romano (1499-1546), son élève. |
|
Pontormo. Déposition (v. 1528). Huile sur bois, 313 × 192 cm, Cappella Capponi, Santa Felicita, Florence. Scène biblique. Après la crucifixion de Jésus-Christ, son corps est descendu de la croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème (descente de croix) puis déposé (déposition du Christ) pour être remis à sa mère Marie. Il s'agit d'un des chefs-d'œuvre de Pontormo et de l'acte de naissance de la bella maniera, c'est-à-dire du maniérisme. L'œuvre se situe dans la filiation de celles de Raphaël et Michel-Ange, mais accentue délibérément mouvements et expressions. La gamme chromatique est également orientée vers le contraste de couleurs vives juxtaposées (rose et bleu, rose et jaune). L'ensemble constitue un instantané saisissant d'un moment unique ; l'enchevêtrement des personnages, qui défie les lois de la physique, paraît à la fois totalement artificiel et esthétiquement sublime. L'objectif est bien là : produire une œuvre émotionnellement forte, d'une composition complexe et idéalisant à l'extrême une scène biblique : pas de traces de sang sur le corps de Christ, qui est d'une propreté parfaite. On peut songer qu'à peu près à la même époque, Matthias Grünewald peignait des crucifixions d'un réalisme extrême. |
|
Francesco Salviati. Déposition (v. 1547). Huile sur bois, 430 × 160 cm, Basilique Santa Croce, Florence. Scène récurrente dans l’art occidental. Le Christ est mort sur la croix et des personnages saints le descendent avant sa mise au tombeau. Jusqu’à Raphaël, la scène était traitée dans un cadre naturel qui faisait apparaître des éléments de végétation en arrière-plan. Le maniérisme réduit le thème à sa quintessence en ne laissant apparaître qu’un enchevêtrement de personnages aux postures improbables mais esthétiquement sublimes. Les contrastes chromatiques appuyés entre les couleurs vives illuminent le tableau et constituent une autre caractéristique du maniérisme. |
|
Simon Vouet. La crucifixion (1636-37). Huile sur toile, 216 × 146 cm, musée des Beaux-Arts de Lyon. « Pour la chapelle privée de son hôtel particulier, le chancelier Pierre Séguier fit appel à Simon Vouet, qui peignit avec ses collaborateurs un ensemble sur le thème de la vie du Christ. Seuls cinq tableaux sont aujourd'hui connus, dont La Crucifixion, la Cène et L’Incrédulité de saint Thomas, conservés au musée des Beaux-Arts de Lyon. Des gravures fournissent cependant des témoignages sur les autres éléments du décor. La Crucifixion, qui était placée au-dessus du maître-autel, se distingue par une grande économie de moyens. |
|
Giovanni Benedetto Castiglione. L'Immaculée Conception avec les saints François d'Assise et Antoine de Padoue (1649-50). Huile sur toile, 367 × 221 cm, Minneapolis Institute of Arts. « La personnalité difficile et violente de Giovanni Benedetto Castiglione a souvent éclipsé ses capacités artistiques et son succès professionnel. Il aurait jeté sa sœur du haut d'un toit, envoyé son frère en prison et failli assassiner son neveu lors d'une bagarre. Pourtant, il a produit des peintures religieuses grandioses et inspirantes. |
|
Giambattista Tiepolo. L’Immaculée Conception (1767-68). Huile sur toile, 279 × 152 cm, musée du Prado, Madrid. « La Vierge apparaît sur la sphère du Monde et la demi-lune, marchant sur le serpent du péché originel, couronnée par la colombe du Saint-Esprit et entourée d'anges et d'une symbolique mariale. Celle-ci est représentée par la tige de fleurs de lys, le palmier, la source et le miroir. Cette scène constitue la manière traditionnelle de représenter l'Immaculée Conception de la Vierge, qui fut conçue sans le péché originel. » (Notice musée du Prado) |
Ajouter un commentaire
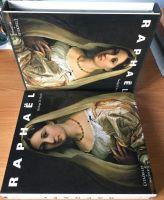
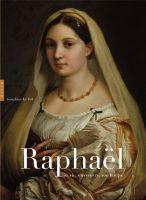
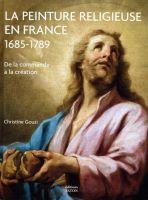















 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa