Elisabeth Vigée Le Brun. Deux portraits de Jeanne du Barry (1781-82)
Cliquer sur les images ci-dessus
PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.
Patrick AULNAS
Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) a réalisé plusieurs portraits de Jeanne du Barry. Elle n’a que 27 ans lorsqu’elle peint les deux portraits choisis ici. Son modèle a 39 ans et vit à Louveciennes dans le château offert par Louis XV. Les deux femmes sont célébrissimes, l’une pour son exceptionnelle précocité d’artiste, l’autre pour avoir été la favorite de Louis XV.
Elisabeth Vigée Le Brun. Madame du Barry (1781)
Huile sur bois, 69,2 × 51,4 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie.
Image HD sur PHILADELPHIA MUSEUM OF ART
Elisabeth Vigée Le Brun. Madame du Barry (1782)
Huile sur toile, 115 × 89,5 cm, National Gallery of Art, Washington.
Image HD sur NATIONAL GALLERY OF ART et GOOGLE ARTS & CULTURE
Jeanne du Barry (1743-1793)
Le destin exceptionnel et tragique de Jeanne du Barry résulte de sa beauté physique. Sans elle, Jeanne Bécu serait restée une inconnue. Le registre paroissial de Vaucouleurs (Meuse) indique sa date de naissance : le 19 août 1743. Elle est, selon l’acte, la « fille naturelle d’Anne Bequs dite Quantiny ». Des hypothèses ont été émises par les historiens concernant son père, mais les documents manquent. Anne Bécu, sa mère, était couturière à Vaucouleurs.
Anne Bécu gagne Paris et devient cuisinière chez le financier Claude Billard Dumonceaux (1705-1772). Elle épouse un domestique de la maison, Nicolas Rançon, en 1849. Le financier n’est pas insensible à la beauté, tant de la mère que de la fille. Jeanne est placée dans une pension religieuse pour jeunes filles de bonne famille de 1753 à 1758. La pension annuelle s’élevant à 500 livres, elle est sans aucun doute payée par Billard Dumonceaux. Intelligente, Jeanne reçoit alors l’éducation des jeunes bourgeoises (écriture, calcul, chant, religion) et acquiert une passion de la lecture.
Les années suivantes (1758-1764) restent peu documentées. Seules des hypothèses ont été faites concernant les emplois éventuels de Jeanne. Une chose est certaine : sa beauté était unanimement admirée. Le prince de Ligne décrit Jeanne dans ses mémoires : « Bien faite, blonde à ravir. Front dégagé, beaux yeux, sourcils à l’avenant, visage ovale avec de petits signes sur la joue pour la rendre piquante comme pas d’autres, bouche au rire leste, peau fine, poitrine à contrarier le monde. » (*)
En 1764, Jeanne rencontre Jean Baptiste Dubarry-Cérès (1723-1794), militaire de Haute-Garonne ayant abandonné sa famille pour vivre à Paris de petits trafics et de libertinage. Il se fait passer pour noble, se présente comme Jean Baptiste du Barry et s’attribue le titre de comte. Jeanne a sans doute eu une brève liaison avec ce personnage, mais elle joue surtout le rôle de maîtresse de maison de Jean-Baptiste du Barry, se faisant même appeler comtesse du Barry. Introduite à Versailles, Jeanne est remarquée par Louis XV (1710-1774) fin 1767 ou début 1768. Le roi a 58 ans et Jeanne 24.
L’idylle devient une liaison stable et le roi souhaite présenter sa nouvelle favorite à la cour. Pour cela, elle doit être mariée. Guillaume du Barry, le frère de Jean-Baptiste fera l’affaire et l’union est célébrée le 1er septembre 1768. Jeanne Bécu, appelée Jeanne Gomard de Vaubernier sur l’acte de mariage, devient officiellement comtesse du Barry. Elle s’installe à Versailles et la présentation à la cour a lieu le 22 avril 1769. Louis XV, de tempérament dépressif, retrouve la joie de vivre auprès de sa favorite. Celle-ci s’adapte parfaitement à la cour. Le roi la couvre de cadeaux et lui donne le château de Louveciennes, qui restera sa résidence préférée, qu’elle agrandira et décorera avec goût.
Château de Jeanne du Barry à Louveciennes
A la mort de Louis XV en 1774, Jeanne du Barry est d’abord placée dans un couvent jusqu’en mai 1775. Elle s’installe ensuite au château de Saint-Vrain, près d’Arpajon, à une trentaine de kilomètres de Paris car le retour à Louveciennes lui est interdit. Enfin, cette interdiction est levée et elle revient à Louveciennes en novembre 1776. Elle y vivra des jours heureux jusqu’à la Révolution de 1789.
Bien qu’amie des philosophes des Lumières, Jeanne du Barry a soutenu la royauté. Après de multiples péripéties, elle est emprisonnée à la prison Sainte-Pélagie à Paris le 22 septembre 1793 et guillotinée le 8 décembre suivant.
Analyse des deux œuvres
Les deux portraits proposent deux approches distinctes du modèle avec le brio coutumier d’Élisabeth Vigée Le Brun.
Elisabeth Vigée Le Brun. Madame du Barry, 1781, détail
Le portrait de 1781 présente une Jeanne du Barry de la vie quotidienne dans les atours d’une jeune femme de l’aristocratie. Le chapeau de paille avec la plume d’autruche est un élément essentiel qui a été utilisé à plusieurs reprises par l’artiste, en particulier dans son autoportrait. Il a pour fonction d’offrir de la femme une image de liberté quelque peu bucolique, s’accordant globalement à l’esprit des Lumières, mais illustrant aussi la spécificité de certaines femmes de l’époque. Jeanne du Barry ou Élisabeth Vigée Le Brun avaient en effet réussi socialement par leurs propres moyens, sans dépendre économiquement d’un homme pendant toute leur vie. Une telle situation restait tout à fait exceptionnelle au 18e siècle. Le petit air de liberté émanant du portrait provient aussi du regard assuré et doux que dirige vers nous le modèle et de la robe simple avec un col de dentelle et un ruban bleu.
Elisabeth Vigée Le Brun. Madame du Barry, 1782, détail
« Une couronne de fleurs rose pâle et de plumes d'autruche blanches bouclées couronne ses longs cheveux gris, qui sont empilés sur sa tête. Des boucles lâches effleurent ses deux épaules. Sa robe de satin argenté resplendissante est ornée d'une délicate dentelle transparente autour du large décolleté plongeant et des manches, et une ceinture rose entoure sa taille étroite. Des bracelets de perles ornent ses poignets. Elle se penche sur sa gauche, à notre droite, pour appuyer son coude gauche sur un piédestal en pierre brun cannelle qui lui arrive à la taille et qui est décoré d'une guirlande et d'un nœud de couleur bronze sur le côté qui nous fait face. Un anneau de fleurs bleues, jaunes, rouges et roses, tissé avec des brins de lierre, pend dans la main qui repose sur le piédestal. »
Elisabeth Vigée Le Brun. Madame du Barry, 1782, détail
Jeanne du Barry apparaît ici sur un fond paysager, accoudée à un élément architectural courant dans les parcs de la haute noblesse. Le statut social est ainsi mis en évidence, tant par le cadre que par l’habillement. Mais le visage reste doux et le regard apaisé, ce qui est loin d’être toujours le cas pour les portraits féminins du même type. Le caractère de Jeanne du Barry correspond à l’image que donne d’elle Élisabeth Vigée Le Brun. Si les caricatures et les propos acerbes n’ont pas manqué dans les écrits de l’époque, les contemporains l’ayant rencontrée évoquent en général sa gentillesse, sa douceur et sa bonté. Ainsi Jacques-Pierre Brissot (1754-1793) écrit dans ses mémoires : « En me rappelant le sourire si plein de grâce et de bonté de Madame du Barry, je suis devenu plus indulgent envers la favorite. » (**). Elle est également très appréciée par la population de Louveciennes.
Comme la marquise de Pompadour (1721-1764), autre favorite célèbre de Louis XV, Jeanne du Barry marque l’histoire de l’art par des chefs-d’œuvre du portrait. La première avait été représentée à de multiples reprises mais les deux portraits les plus remarquables sont ceux de Maurice Quentin de la Tour (1755) et de François Boucher (1756). De la seconde, dernière favorite du roi, on possède également un grand nombre de portraits, les deux analysés ci-dessus constituant sans doute l’acmé de cet ensemble.
Autres compositions sur le même thème
Voici quelques autres portraits de Jeanne du Barry. Il en existe beaucoup d’autres, de même que de nombreuses gravures.

François-Hubert Drouais. Portrait de la comtesse Du Barry en Flore (1769). Huile sur toile, 70 × 58 cm, château de Versailles. « Peintre attitré de Madame Du Barry, François-Hubert Drouais l’a représentée à de multiples reprises. Il exposa au Salon de 1769, année de la présentation de la nouvelle favorite à la Cour, deux portraits la montrant en Flore et en costume de chasse. Entre 1770 et 1774, le portrait en Flore fit l’objet, à la demande de Madame Du Barry, de sept à huit répliques ou copies, chacune légèrement différente, destinées à son entourage. Trois versions sont aujourd’hui conservées en collection publique : au musée des beaux-arts d’Agen, à la National Gallery de Washington et au musée du Prado à Madrid. |
|
Jean-Baptiste Greuze. Portrait de la Comtesse Du Barry (v. 1771). Huile sur toile, 60 × 47 cm, collection particulière. « Selon Edgar Munhall, ce portrait de la comtesse a été peint au sommet de son succès et de son influence, vers 1771, l'année où son célèbre domaine de Louveciennes a été achevé. Elle est représentée de manière plutôt désinvolte, vêtue d'une robe de nuit, sans bijoux ni autres ornements, les cheveux tombant. Sa pose suggère qu'elle s'est soudainement détournée de son miroir pour s'adresser à l'artiste. » (Commentaire Sotheby’s) |
|
François-Hubert Drouais. Jeanne Bécu, comtesse Du Barry, en Flore (1773). Huile sur toile, 73 × 60 cm, château de Versailles. « Une des cinq copies autographes du portrait de Madame Du Barry présenté au Salon de 1773, n°80 : collection du comte Demidoff, prince de San Donato » (Commentaire château de Versailles) |
|
Elisabeth Vigée Le Brun. Portrait de la Madame Du Barry (1789 et 1820). Huile sur toile, 130 × 98 cm, collection particulière. On suppose que l’artiste n’a terminé que vers 1820 ce portrait commencé à Louveciennes en 1789, mais resté inachevé par suite des troubles révolutionnaires. |
_________________________________________
(*) Cité par Stéphanie Soulier
(**) Cité par Wikipédia
Ajouter un commentaire
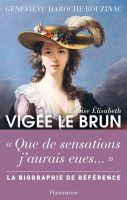
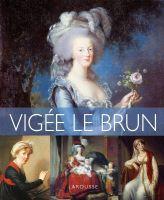
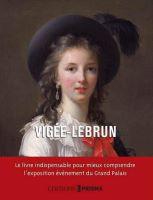









 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa