Jean Fouquet
Cliquer sur les images ci-dessus
PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.
Patrick AULNAS
Autoportrait
Jean Fouquet. Autoportrait (v. 1450)
Émail sur cuivre, diamètre 6 cm, musée du Louvre, Paris.
Biographie
1415/20-1478/81
Les informations sur la vie de Jean Fouquet sont peu nombreuses. Elles reposent sur des annotations éparses dans des documents d'époque ou sur des interprétations de ses œuvres, des influences subies et de leurs sources possibles.
Fouquet naît à Tours entre 1415 et 1420. Sa formation artistique fait l'objet de supputations, mais eu égard à son savoir-faire exceptionnel dans le domaine de l'enluminure, il est vraisemblable qu'il fut apprenti dans des ateliers d'enlumineurs. Les historiens citent en particulier un grand enlumineur du début du 15e siècle dont on ignore l'identité : le maître de Bedford. Celui-ci avait un atelier à Paris et il travailla à plusieurs reprises pour le duc de Bedford, Jean de Lancaster (1389-1435).
Entre 1443 et 1447 (on ignore la date exacte), Fouquet fait un voyage en Italie. Vers 1446, il peint sur toile un portrait du pape Eugène IV (1383-1447) qui ne nous est pas parvenu mais dont on possède une gravure. Le voyage en Italie a certainement permis au peintre français de rencontrer de grands noms de la peinture italienne : on cite en particulier Fra Angelico car son influence est notable sur certaines œuvres de Fouquet. Un portrait du bouffon Gonella qui exerçait ses talents pour la famille d'Este de Ferrare montre que Fouquet a séjourné dans plusieurs villes italiennes.
A la fin de la décennie 1440-50, Fouquet est de retour en France et s'installe à Tours où il ouvre un atelier de peintre et enlumineur. Sa réputation auprès de la famille royale, de l'aristocratie et du clergé, principaux commanditaires, est considérable. Il travaille pour la famille royale et les grands du royaume. Voici quelques exemples.
- Charles VII (1403-1461) : portrait (v. 1450-55)
- Son fils Louis XI (1423-1483) : portrait (v. 1475, perdu)
- Étienne Chevalier (1410-1474), trésorier de France, c'est-à-dire administrateur des finances royales : Diptyque de Melun (v. 1452-58), Livre d'heures (1452-60)
- Guillaume de Jouvenel des Ursins (1401-1472), chancelier de France, une sorte de ministre de la justice : portrait (v. 1460-65)
- Jacques d'Armagnac (1433-1477), duc de Nemours : Manuscrit (v. 1470) d'une traduction des Antiquités judaïques de Flavius Josèphe (environ 37-100 après J.-C.), historiographe juif.
C'est ce dernier manuscrit qui a permis aux historiens de l'art de caractériser le style de Jean Fouquet et de lui attribuer ensuite de nombreuses autres œuvres attribuées auparavant à d'autres peintres. Ce manuscrit des Antiquités Judaïques, enluminé par Fouquet, était devenu la possession du duc de Bourbon par héritage. Son secrétaire, François Robertet, inscrivit en 1477, à la dernière page du manuscrit, la note suivante : « En ce livre à douze histoires, les trois premières de l'enlumineur du duc Jean de Berry et les neuf autres de la main du bon peintre et enlumineur du bon roi Louis XI, Jehan Fouquet, natif de Tours ». Pourquoi cette annotation a-t-elle une telle importance ? Robertet n'est pas un secrétaire au sens moderne. Il appartient à une famille qui joue un rôle important dans la famille royale. Ce sont des gens cultivés, également mécènes, que l'on qualifierait aujourd'hui de hauts fonctionnaires. Cette inscription de la main de François Robertet est donc celle d'un connaisseur de l'art de l'époque. Elle constitue aussi l'unique certification d'époque en notre possession concernant l'œuvre de Fouquet.
 Diptyque de Melun. Etienne Chevalier et Saint Etienne (1452-58)
Diptyque de Melun. Etienne Chevalier et Saint Etienne (1452-58)
Huile sur bois, 93 × 85 cm, Gemäldegalerie, Berlin
Analyse détaillée
Jean Fouquet meurt à une date inconnue située entre 1478 et 1481, probablement à Tours. Il sera à peu près oublié après sa mort Il faut attendre le 19e siècle pour que des historiens entreprennent des recherches pour tenter de reconstituer l'œuvre du maître de Tours. En 1904, la Bibliothèque nationale de France organise une exposition sur les « primitifs français » où Fouquet tient une place éminente.
Œuvre
Si on n'y trouve pas la foisonnante créativité de la Première Renaissance italienne, la France du 15e siècle ne reste pas à l'écart du renouveau de l'art. Jean Fouquet est le peintre et enlumineur qui parviendra le mieux à réaliser une synthèse entre le gothique international, auquel il a été formé dans sa jeunesse, et les influences flamandes et italiennes. Du gothique, il conserve les couleurs vives et contrastantes, en particulier dans ses enluminures. Aux flamands, il emprunte le réalisme et le sens du détail. Il est redevable aux italiens de la perspective linéaire (éléments d'architecture, par exemple, marquant nettement la ligne de fuite) et atmosphérique (dégradé de couleurs vers l'horizon, par exemple pour le ciel).
 Enluminure des Chroniques de France. Couronnement de Louis VI le Gros (1455-60)
Enluminure des Chroniques de France. Couronnement de Louis VI le Gros (1455-60)
Portraitiste, peintre de scènes religieuses, enlumineur de manuscrits, créateur de motifs décoratifs pour tapisseries et vitraux, Fouquet a une activité éclectique qui correspond à sa renommée. Il est sans doute considéré en France comme le plus habile des peintres de l'époque et l'on fait appel à lui pour tout ce qui relève de la peinture, de l'illustration, de la décoration. Giorgio Vasari (*) est d'ailleurs tout à fait admiratif devant les enluminures de Fouquet :
« Les motifs gracieux et fins y sont maniés avec une grande aisance. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est l'emploi heureux de la perspective linéaire et du clair-obscur, qui donne à quelques-uns de ces petits tableaux un ensemble et une tenue tout-à-fait hors de ligne, et que nous n'avons vus dans aucun autre ouvrage contemporain de ce genre. Il faut ajouter à cela que, malgré la variété des couleurs, tous les tons sont si bien rompus, qu'ils produisent un effet suave et harmonieux, d'un charme tout particulier. »
Les tableaux
Seule une petite partie des œuvres de Fouquet nous est parvenue. Portraitiste exceptionnel, il traite ses modèles avec un réalisme totalement dénué de flagornerie. Il est également capable de réaliser des compositions religieuses complexes dans lesquelles transparaît sa culture picturale à la fois italienne et flamande.
|
Le bouffon Gonella (v. 1445). Huile sur bois, 36 × 24 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne. Lors de son séjour en Italie, Fouquet passe par Ferrare où règne la famille d'Este. A la cour se perpétue la tradition du bouffon (le fou du roi) chargé de faire rire et de détendre l'atmosphère. Pietro Gonella, immortalisé par Fouquet, est le bouffon de la cour. Le peintre a su capter magistralement l'expression du visage et a apporté un soin minutieux aux détails (peau, barbe, nez, rides), s'inspirant en cela de la peinture flamande. Les autres éléments du portrait sont plus schématiques, les mains en particulier. |
|
Portrait de Charles VII (v. 1450-55). Huile sur bois, 86 x 72 cm, musée du Louvre, Paris. Ce portrait sans concession de Charles VII (1403-1461), alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'inspire davantage de la tradition flamande qu'italienne, où dominait la représentation de profil. Il s'agit d'une huile sur bois. Le roi est en représentation comme en témoignent les rideaux, mais les attributs de la royauté (couronne, sceptre) sont absents. A l'évidence, le traitement du visage montre que le peintre n'a pas cherché à flatter son modèle : voilà sans doute un Charles VII assez proche du réel. L'inscription seule glorifie le souverain : « LE TRES VICTORIEUX ROY DE FRANCE, CHARLES SEPTIESME DE CE NOM ». |
|
Diptyque de Melun. Etienne Chevalier et saint Etienne (1452-58). Huile sur bois, 93 × 85 cm. Ce diptyque avait été commandé par Etienne Chevalier, trésorier de France, pour orner la collégiale Notre-Dame de Melun. Il est aujourd'hui conservé à la Gemäldegalerie de Berlin pour la partie gauche (Etienne Chevalier) et au Musée royal des beaux-arts d'Anvers pour la partie droite (Vierge). Le panneau de gauche est de tonalité plus italienne : Etienne Chevalier, au premier plan, est présenté à la Vierge (panneau de droite) par saint Etienne, son patron. Le style d'inspiration italienne se caractérise par la perspective architecturale en arrière-plan et le personnage du saint où certains auteurs ont discerné l'influence de Fra Angelico que Fouquet a peut-être rencontré en Italie. |
|
Diptyque de Melun. Vierge à l'Enfant entourée d'anges (1452-58). Huile sur bois, 91,8 × 83,3 cm. Cette Vierge forme le panneau de droite du diptyque. Surprenante et audacieuse représentation de la Vierge, qui s'apprête à allaiter (réalisme) et qui, simultanément, semble une apparition quelque peu spectrale (mythologie fantastique ?). Le contraste marqué entre le fond (angelots bleu et rouge) et le personnage de la Vierge à l'Enfant (blanc marmoréen) indique une volonté de l'artiste d'interpeler l'observateur. Le style reste proche du gothique international avec des influences flamandes. Les historiens sont en désaccord sur le modèle : selon certains, il s'agirait d'Agnès Sorel (1422-1450), la maîtresse de Charles VII, mais d'autres rejettent l'hypothèse. |
|
Portrait de Guillaume Jouvenel des Ursins (1460-65). Huile sur bois, 93 × 73,2 cm, musée du Louvre, Paris. Il s'agit du Chancelier de France qui a environ 60 ans. L'inspiration nordique est nette : réalisme et souci du détail pour le visage et l'arrière-plan très chargé où des signes héraldiques de la famille apparaissent. Là encore, le modèle n'est pas flatté, mais la posture pieuse et la richesse du vêtement devaient suffire pour lui complaire. |
|
Pietà de Nouans (1450-65). Huile sur bois, 146 × 237 cm. Il s'agit du plus grand tableau de Fouquet qui nous soit parvenu (168 × 259 cm avec son cadre). Il est conservé dans l'église paroissiale Saint-Martin de Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire, France). Le commanditaire, qui est représenté agenouillé en blanc sur la droite, n'est pas connu avec certitude. Le Christ est déposé sur les genoux de la Vierge, sa mère, par Joseph d'Arimathie et saint Nicodème. Derrière la Vierge, saint Jean (en rouge). Cette huile sur bois traite un thème religieux ressassé, en particulier par les flamands, mais constitue une composition originale par la position des personnages (le Christ complètement à gauche) et le chromatisme (le fond bleu est tout à fait atypique). Elle permet d'apprécier (avec le diptyque de Melun) le potentiel exceptionnel de Jean Fouquet. |
Les enluminures
L'enluminure est une peinture ou un dessin exécuté à la main, qui décore ou illustre un texte, la plupart du temps un manuscrit. Les techniques de l'imprimerie et de la gravure feront presque disparaître l'enluminure. Toutefois, il existe quelques livres imprimés qui en sont ornés.
Le livre d'heures est le type le plus courant d'ouvrage médiéval enluminé. Chaque livre d'heures est unique, mais tous contiennent une collection de textes, de prières et de psaumes avec des illustrations correspondantes et constituant un recueil de base pour la pratique de la religion catholique. Avec le temps, leur texte s'enrichit de données plus profanes telles qu'un calendrier avec les prières et les messes pour certains jours saints. Le livre d'heures est le premier livre acheté et bien souvent le seul. Le plus célèbre pour la qualité de ses enluminures est Les Très Riches Heures du duc de Berry.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour visionner d'autres œuvres sur GOOGLE ARTS & CULTURE, cliquer sur le nom du peintre :
_______________________________
(*) Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (première édition 1550, remaniée en 1568).
Ajouter un commentaire




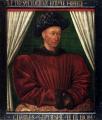



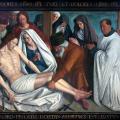


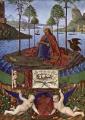



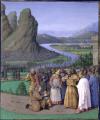
 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa