- Accueil
- Chronique
- Chronique littéraire
- J. J. Rousseau, Les Confessions : Extraits commentés et illustrés (1)
J. J. Rousseau, Les Confessions : Extraits commentés et illustrés (1)
PRÉSENTATION
Cliquer sur les images pour les agrandir
« Je forme une entreprise qui n'eut jamais d’exemple, et dont l’exécution n'aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme, ce sera moi. »
Voici quelques extraits significatifs de l’un des textes fondateurs de la littérature moderne. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) cherche à définir sa propre singularité et à se justifier au regard des hommes de son temps et de ceux du futur. Contrairement à ce qu’il affirme, il aura une multitude d’imitateurs car il crée l’archétype de l’autobiographie contemporaine. Mais il y a plus : placer le monde intérieur de l’individu et principalement ses sentiments au premier plan constitue une innovation majeure qui débouchera sur le romantisme. Sans Les Confessions, pas de Mémoires d’outre-tombe. Sans Rousseau, pas de Chateaubriand ni de Proust. L’influence de l’ouvrage sera donc considérable.
Le grand écrivain possède un style qui s’adapte au discours : émouvant, lyrique, orgueilleux, sarcastique, poétique. Car sa vie, aventureuse, conflictuelle et créative, nécessite une riche palette. Ainsi, la première partie (livres I à VI, de 1712 à 1741) retrace les souvenirs de jeunesse et les multiples péripéties de ce Kerouac du 18e siècle qui parcourt les chemins de Suisse, de Savoie, d’Italie. Le jeune homme émotif, sensible, rebelle, instable, passionnément épris de liberté, s’essaie à de multiples activités sans jamais en choisir aucune, pratique le ménage à trois et finit par trouver aux Charmettes un bonheur qu’il parvient à nous communiquer dans des lignes inoubliables :
« Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. »
La seconde partie (livres VII à XII, de 1741 à 1765) nous précipite dans les luttes et les souffrances du compositeur, de l’écrivain, du philosophe qui doit survivre dans un monde rude et hostile, mais aussi et avant tout, créer. Orgueilleux, conscient de sa forte originalité intellectuelle et morale, il doit composer avec les puissants qui lui viennent en aide lorsqu’ils ont assez de clairvoyance pour soupçonner le génie derrière l’individu solitaire et inquiet qui, au fil du temps, deviendra de plus en plus paranoïaque.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE PREMIER (1712-1728)
Résumé
Rousseau relate d’abord sa petite enfance à Genève où son père était horloger. Celui-ci doit quitter Genève à la suite d’une querelle et Jean-Jacques est placé sous la tutelle de son oncle Bernard. En 1722, il est mis en pension à Bossey chez M. Lambercier et revient à Genève en 1724. Placé chez un greffier comme apprenti, le travail de bureau ne lui convient pas ; il entame un apprentissage de graveur. Un soir, ayant été se promener en dehors de Genève, il trouve les portes de la ville fermées. Il décide de partir.
__________________________________________________________________________________________________
« Une entreprise qui n’eut jamais d’exemple »
Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi.
Moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus ; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu.
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon ; et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus : méprisable et vil quand je l'ai été ; bon, généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose : je fus meilleur que cet homme-là.
Rousseau et l’argent
J'entrerais dans les plus insipides détails, si je suivais dans l'emploi de mon argent, soit par moi, soit par d'autres, l'embarras, la honte, la répugnance, les inconvénients, les dégoûts de toute espèce que j'ai toujours éprouvés. A mesure qu'avançant dans ma vie le lecteur prendra connaissance de mon humeur, il sentira tout cela sans que je m'appesantisse à le lui dire.
Cela compris, on comprendra sans peine une de mes prétendues contradictions, celle d'allier une avarice presque sordide avec le plus grand mépris pour l'argent. C'est un meuble pour moi si peu commode, que je ne m'avise pas même de désirer celui que je n'ai pas, et que quand j'en ai je le garde longtemps sans le dépenser, faute de savoir l'employer à ma fantaisie : mais l'occasion commode et agréable se présente-t-elle, j'en profite si bien que ma bourse se vide avant que je m'en sois aperçu. Du reste, ne cherchez pas en moi le tic des avares, celui de dépenser pour l'ostentation ; tout au contraire, je dépense en secret et pour le plaisir : loin de me faire gloire de dépenser, je m'en cache. Je sens si bien que l'argent n'est pas à mon usage, que je suis presque honteux d'en avoir, encore plus de m'en servir. Si j'avais eu jamais un revenu suffisant pour vivre commodément, je n'aurais point été tenté d'être avare, j'en suis très sûr ; je dépenserais tout mon revenu sans chercher à l'augmenter : mais ma situation précaire me tient en crainte. J'adore la liberté ; j'abhorre la gêne, la peine, l'assujettissement. Tant que dure l'argent que j'ai dans ma bourse, il assure mon indépendance ; il me dispense de m'intriguer pour en trouver d'autre, nécessité que j'eus toujours en horreur ; mais de peur de le voir finir, je le choie. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté ; celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Voilà pourquoi je serre bien et ne convoite rien.
Mon désintéressement n'est donc que paresse ; le plaisir d'avoir ne vaut pas la peine d'acquérir : et ma dissipation n'est encore que paresse ; quand l'occasion de dépenser agréablement se présente, on ne peut trop la mettre à profit. Je suis moins tenté de l'argent que des choses, parce qu'entre l'argent et la possession désirée il y a toujours un intermédiaire ; au lieu qu'entre la chose même et sa jouissance il n'y en a point. Je vois la chose, elle me tente ; si je ne vois que le moyen de l'acquérir, il ne me tente pas.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE DEUXIÈME (1728-1731)
Résumé
Après avoir erré quelques jours autour de Genève, Jean-Jacques est recueilli par des paysans qui saisisse M. de Pontverre du problème. Celui-ci décide de transformer le jeune protestant en une nouvelle recrue pour l’église catholique et l’envoie à Annecy, chez Mme de Warens, elle-même convertie, qui se charge de ce genre de services. La première rencontre avec Mme de Warens est déjà pour Jean-Jacques un prélude à l’amour futur : elle le fascine. Elle envoie Rousseau à Turin dans un établissement religieux affecté à la conversion de jeunes gens plus ou moins désocialisés. Le séjour dans cet hospice de Turin se situe en avril 1728. Jean-Jacques a donc seize ans. Une fois converti, sa liberté lui est rendue et un petit pécule lui est remis. Il profite quelque temps de sa liberté à Turin, puis entre comme domestique chez Mme de Vercellis où se situe l’épisode du vol du ruban.
_______________________________________________________________________________________________________________
Le jeune Jean-Jacques face à au désir masculin
L'un de ces deux bandits qui se disaient Mores me prit en affection. Il m'accostait volontiers, causait avec moi dans son baragouin franc, me rendait de petits services, me faisait part quelquefois de sa portion à table, et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m'était fort incommode. Quelque effroi que j'eusse naturellement de ce visage de pain d'épice orné d'une longue balafre, et de ce regard allumé qui semblait plutôt furieux que tendre, j'endurais ces baisers en me disant en moi- même : Le pauvre homme a conçu pour moi une amitié bien vive ; j'aurais tort de le rebuter. Il passait par degrés à des manières plus libres, et me tenait quelquefois de si singuliers propos, que je croyais que la tête lui avait tourné. Un soir il voulut venir coucher avec moi ; je m'y opposai, disant que mon lit était trop petit. Il me pressa d'aller dans le sien ; je le refusai encore : car ce misérable était si malpropre et puait si fort le tabac mâché, qu'il me faisait mal au cœur. Le lendemain, d'assez bon matin, nous étions tous deux seuls dans la salle d'assemblée ; il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu'il en était effrayant. Enfin il voulut passer par degrés aux privautés les plus choquantes, et me forcer, en disposant de ma main, d'en faire autant. Je me dégageai impétueusement en poussant un cri et faisant un saut en arrière ; et, sans marquer ni indignation ni colère, car je n'avais pas la moindre idée de ce dont il s'agissait, j'exprimai ma surprise et mon dégoût avec tant d'énergie, qu'il me laissa là : mais tandis qu'il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit soulever le cœur. Je m'élançai sur le balcon, plus ému, plus troublé, plus effrayé même que je ne l'avais été de ma vie, et prêt à me trouver mal.
Le vol du ruban
La seule mademoiselle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose et argent déjà vieux. Beaucoup d'autres meilleures choses, étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je le volai ; et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et enfin je dis, en rougissant, que c'est Marion qui me l'a donné. Marion était une jeune Mauriennoise dont madame de Vercellis avait fait sa cuisinière quand, cessant de donner à manger, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de bons bouillons que de ragoûts fins. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer ; d'ailleurs bonne fille, sage, et d'une fidélité à toute épreuve. C'est ce qui surprit quand je la nommai. L'on n'avait guère moins de confiance en moi qu'en elle, et l'on jugea qu'il importait de vérifier lequel était le fripon des deux. On la fit venir : l'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban : je la charge effrontément ; elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons, et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance, mais sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui ne m'a jamais fait de mal ; et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma déclaration, et lui soutiens en face qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer, et ne me dit que ces mots : Ah ! Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. Voilà tout. Elle continua de se défendre avec autant de simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de supposer d'un côté une audace aussi diabolique, et de l'autre une aussi angélique douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour moi.
Dans le tracas où l'on était, on ne se donna pas le temps d'approfondir la chose ; et le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été vaine ; elle ne cesse pas un seul jour de s'accomplir.
J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie ; mais il n'y a pas d'apparence qu'elle ait après cela trouvé facilement à se bien placer : elle emportait une imputation cruelle à son honneur de toutes manières. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin c'était un vol, et, qui pis est, employé à séduire un jeune garçon : enfin, le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de vices étaient réunis. Je ne regarde pas même la misère et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposée. Qui sait, à son âge, où le découragement de l'innocence avilie a pu la porter ! Eh ! si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre pire que moi !
Ce souvenir cruel me trouble quelquefois, et me bouleverse au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime comme s'il n'était commis que d'hier. Tant que j'ai vécu tranquille il m'a moins tourmenté, mais au milieu d'une vie orageuse il m'ôte la plus douce consolation des innocents persécutés : il me fait bien sentir ce que je crois avoir dit dans quelque ouvrage, que le remords s'endort durant un destin prospère, et s'aigrit dans l'adversité. Cependant je n'ai jamais pu prendre sur moi de décharger mon cœur de cet aveu dans le sein d'un ami. La plus étroite intimité ne me l'a jamais fait faire à personne, pas même à madame de Warens. Tout ce que j'ai pu faire a été d'avouer que j'avais à me reprocher une action atroce, mais jamais je n'ai dit en quoi elle consistait. Ce poids est donc resté jusqu'à ce jour sans allégement sur ma conscience ; et je puis dire que le désir de m'en délivrer en quelque sorte a beaucoup contribué à la résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE TROISIÈME (1728-1731)
Résumé
Jean-Jacques retourne pour quelques semaines chez Mme de Warens puis, en février 1729, entre comme domestique chez M. de Gouvon à Turin. Il est séduit par Melle de Breil mais celle-ci ne le remarque que lorsqu’il fait état d’une certaine culture. Rousseau quitte cette maison pour aller courir les chemins avec Bâcle, un ancien camarade d’apprentissage. Les deux jeunes gens se dirigent à pied vers Annecy. Rousseau souhaite par-dessus tout revoir Mme de Warens. Elle l’accueille à nouveau et l’affecte chez elle à la fabrication d’élixirs. « Cette vie était trop douce pour pouvoir durer ». Mme de Warens essaiera de placer Rousseau de diverses façons (auprès de M. D’Aubonne, puis au séminaire) mais le jeune homme est rétif et les échecs s’accumulent. Il revient chez Mme de Warens où il s’initie à la musique auprès de M. Le Maître, maître de musique de la cathédrale. Il accompagne Le Maître à Lyon, l’abandonne , puis revient à Annecy. Mme de Warens est partie pour Paris.
_______________________________________________________________________________
Mademoiselle de Breil et le mérite avili vengé des outrages de la fortune.
Mademoiselle de Breil était une jeune personne à peu près de mon âge, bien faite, assez belle, très blanche, avec des cheveux très noirs, et, quoique brune, portant sur son visage cet air de douceur des blondes auquel mon coeur n'a jamais résisté. L'habit de cour, si favorable aux jeunes personnes, marquait sa jolie taille, dégageait sa poitrine et ses épaules, et rendait son teint encore plus éblouissant par le deuil qu'on portait alors. On dira que ce n'est pas à un domestique de s'apercevoir de ces choses-là. J'avais tort sans doute ; mais je m'en apercevais toutefois, et même je n'étais pas le seul. Le maître d'hôtel et les valets de chambre en parlaient quelquefois à table avec une grossièreté qui me faisait cruellement souffrir. La tête ne me tournait pourtant pas au point d'être amoureux tout de bon. Je ne m'oubliais point ; je me tenais à ma place, et mes désirs mêmes ne s'émancipaient pas. J'aimais à voir mademoiselle de Breil, à lui entendre dire quelques mots qui marquaient de l'esprit, du sens, de l'honnêteté : mon ambition, bornée au plaisir de la servir, n'allait point au delà de mes droits. A table j'étais attentif à chercher l'occasion de les faire valoir. Si son laquais quittait un moment sa chaise, à l'instant on m'y voyait établi : hors de là je me tenais vis-à-vis d'elle ; je cherchais dans ses yeux ce qu'elle allait demander, j'épiais le moment de changer son assiette. Que n'aurais-je point fait pour qu'elle daignât m'ordonner quelque chose, me regarder, me dire un seul mot ! mais point : j'avais la mortification d'être nul pour elle ; elle ne s'apercevait pas même que j'étais là. Cependant son frère, qui m'adressait quelquefois la parole à table, m'ayant dit je ne sais quoi de peu obligeant, je lui fis une réponse si fine et si bien tournée, qu'elle y fit attention, et jeta les yeux sur moi. Ce coup d'oeil, qui fut court, ne laissa pas de me transporter. Le lendemain l'occasion se présenta d'en obtenir un second, et j'en profitai. On donnait ce jour-là un grand dîner, où pour la première fois je vis avec beaucoup d'étonnement le maître d'hôtel servir l'épée au côté et le chapeau sur la tête. Par hasard on vint à parler de la devise de la maison de Solar, qui était sur la tapisserie avec les armoiries, Tel fiert qui ne tue pas. Comme les Piémontais ne sont pas pour l'ordinaire consommés dans la langue française, quelqu'un trouva dans cette devise une faute d'orthographe, et dit qu'au mot fiert il ne fallait point de t.
Le vieux comte de Gouvon allait répondre ; mais ayant jeté les yeux sur moi, il vit que je souriais sans oser rien dire : il m'ordonna de parler. Alors je dis que je ne croyais pas que le t fût de trop ; que fiert était un vieux mot français qui ne venait pas du mot ferus, fier, menaçant, mais du verbe ferit, il frappe, il blesse ; qu'ainsi la devise ne me paraissait pas dire, Tel menace, mais Tel frappe qui ne tue pas.
Tout le monde me regardait et se regardait sans rien dire. On ne vit de la vie un pareil étonnement. Mais ce qui me flatta davantage fut de voir clairement sur le visage de mademoiselle de Breil un air de satisfaction. Cette personne si dédaigneuse daigna me jeter un second regard qui valait tout au moins le premier ; puis, tournant les yeux vers son grand-papa, elle semblait attendre avec une sorte d'impatience la louange qu'il me devait, et qu'il me donna en effet si pleine et entière et d'un air si content, que toute la table s'empressa de faire chorus. Ce moment fut court, mais délicieux à tous égards. Ce fut un de ces moments trop rares qui replacent les choses dans leur ordre naturel, et vengent le mérite avili des outrages de la fortune.
Chez Madame de Warens
Elle habitait une vieille maison, mais assez grande pour avoir une belle pièce de réserve, dont elle fit sa chambre de parade, et qui fut celle où l'on me logea. Cette chambre était sur le passage dont j'ai parlé, où se fit notre première entrevue ; et au delà du ruisseau et des jardins on découvrait la campagne. Cet aspect n'était pas pour le jeune habitant une chose indifférente.
C'était depuis Bossey la première fois que j'avais du vert devant mes fenêtres. Toujours masqué par des murs, je n'avais eu sous les yeux que des toits ou le gris des rues. Combien cette nouveauté me fut sensible et douce ! elle augmenta beaucoup mes dispositions à l'attendrissement. Je faisais de ce charmant paysage encore un des bienfaits de ma chère patronne : il me semblait qu'elle l'avait mis là tout exprès pour moi ; je m'y plaçais paisiblement auprès d'elle ; je la voyais partout entre les fleurs et la verdure ; ses charmes et ceux du printemps se confondaient à mes yeux. Mon cœur, jusqu'alors comprimé, se trouvait plus au large dans cet espace, et mes soupirs s'exhalaient plus librement parmi ces vergers.
On ne trouvait pas chez madame de Warens la magnificence que j'avais vue à Turin ; mais on y trouvait la propreté, la décence, et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne s'allie jamais. Elle avait peu de vaisselle d'argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins étrangers ; mais l'une et l'autre étaient bien garnies au service de tout le monde, et dans des tasses de faïence elle donnait d'excellent café. Quiconque la venait voir était invité à dîner avec elle ou chez elle ; et jamais ouvrier, messager ou passant ne sortait sans manger ou boire. Son domestique était composé d'une femme de chambre fribourgeoise assez jolie, appelée Merceret, d'un valet de son pays appelé Claude Anet, dont il sera question dans la suite, d'une cuisinière, et de deux porteurs de louage quand elle allait en visite, ce qu'elle faisait rarement. Voilà bien des choses pour deux mille livres de rente ; cependant son petit revenu bien ménagé eut pu suffire à tout cela dans un pays où la terre est très bonne et l'argent très rare. Malheureusement l'économie ne fut jamais sa vertu favorite : elle s'endettait, elle payait ; l'argent faisait la navette, et tout allait.
La manière dont son ménage était monté était précisément celle que j'aurais choisie : on peut croire que j'en profitais avec plaisir. Ce qui m'en plaisait moins était qu'il fallait rester très longtemps à table. Elle supportait avec peine la première odeur du potage et des mets ; cette odeur la faisait presque tomber en défaillance, et ce dégoût durait longtemps. Elle se remettait peu à peu, causait, et ne mangeait point. Ce n'était qu'au bout d'une demi-heure qu'elle essayait le premier morceau. J'aurais dîné trois fois dans cet intervalle ; mon repas était fait longtemps avant qu'elle eût commencé le sien. Je recommençais de compagnie ; aussi je mangeais pour deux, et ne m'en trouvais pas plus mal. Enfin je me livrais d'autant plus au doux sentiment du bien-être que j'éprouvais auprès d'elle, que ce bien-être dont je jouissais n'était mêlé d'aucune inquiétude sur les moyens de le soutenir. N'étant point encore dans l'étroite confidence de ses affaires, je les supposais en état d'aller toujours sur le même pied. J'ai retrouvé les mêmes agréments dans sa maison par la suite ; mais, plus instruit de sa situation réelle, et voyant qu'ils anticipaient sur ses rentes, je ne les ai plus goûtés si tranquillement. La prévoyance a toujours gâté chez moi la jouissance. J'ai vu l'avenir à pure perte ; je n'ai jamais pu l'éviter.
Dès le premier jour, la familiarité la plus douce s'établit entre nous au même degré où elle a continué tout le reste de sa vie. Petit fut mon nom ; Maman fut le sien ; et toujours nous demeurâmes Petit et Maman, même quand le nombre des années en eut presque effacé la différence entre nous. Je trouve que ces deux noms rendent à merveille l'idée de notre ton, la simplicité de nos manières, et surtout la relation de nos cœurs. Elle fut pour moi la plus tendre des mères, qui jamais ne chercha son plaisir, mais toujours mon bien ; et si les sens entrèrent dans mon attachement pour elle, ce n'était pas pour en changer la nature mais pour le rendre seulement plus exquis, pour m'enivrer du charme d'avoir une maman jeune et jolie qu'il m'était délicieux de caresser : je dis caresser au pied de la lettre, car jamais elle n'imagina de m'épargner les baisers ni les plus tendres caresses maternelles, et jamais il n'entra dans mon cœur d'en abuser. On dira que nous avons pourtant eu à la fin des relations d'une autre espèce ; j'en conviens, mais il faut attendre ; je ne puis tout dire à la fois.
Monsieur d’Aubonne, fin psychologue.
Madame de Warens m'envoya chez lui deux ou trois matins de suite, sous prétexte de quelque commission, et sans me prévenir de rien. Il s'y prit très bien pour me faire jaser, se familiarisa avec moi, me mit à mon aise autant qu'il était possible, me parla de niaiseries et de toutes sortes de sujets, le tout sans paraître m'observer, sans la moindre affectation, et comme si, se plaisant avec moi, il eût voulu converser sans gêne. J'étais enchanté de lui. Le résultat de ses observations fut que, malgré ce que promettaient mon extérieur et ma physionomie animée, j'étais, sinon tout à fait inepte, au moins un garçon de peu d'esprit, sans idées, presque sans acquis, très borné en un mot à tous égards, et que l'honneur de devenir quelque jour curé de village était la plus haute fortune à laquelle je dusse aspirer. Tel fut le compte qu'il rendit de moi à madame de Warens. Ce fut la seconde ou troisième fois que je fus ainsi jugé : ce ne fut pas la dernière, et l'arrêt de M. Masseron a souvent été confirmé.
La cause de ces jugements tient trop à mon caractère pour n'avoir pas ici besoin d'explication ; car en conscience on sent bien que je ne puis sincèrement y souscrire, et qu'avec toute l'impartialité possible, quoi qu'aient pu dire messieurs Masseron, d'Aubonne et beaucoup d'autres, je ne les saurais prendre au mot.
Deux choses presque inalliables s'unissent en moi sans que j'en puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne se présentent jamais qu'après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n'appartiennent pas au même individu. Le sentiment, plus prompt que l'éclair, vient remplir mon âme ; mais, au lieu de m'éclairer, il me brûle et m'éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. Je suis emporté, mais stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu'il y a d'étonnant est que j'ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même, pourvu qu'on m'attende : je fais d'excellents impromptus à loisir, mais sur le temps je n'ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une assez jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. Quand je lus le trait d'un duc de Savoie qui se retourna, faisant route, pour crier : A votre gorge, marchand de Paris, je dis : Me voilà.
Cette lenteur de penser jointe à cette vivacité de sentir, je ne l'ai pas seulement dans la conversation, je l'ai même seul et quand je travaille. Mes idées s'arrangent dans ma tête avec la plus incroyable difficulté : elles y circulent sourdement, elles y fermentent jusqu'à m'émouvoir, m'échauffer, me donner des palpitations ; et, au milieu de toute cette émotion, je ne vois rien nettement, je ne saurais écrire un seul mot ; il faut que j'attende. Insensiblement ce grand mouvement s'apaise, ce chaos se débrouille, chaque chose vient se mettre à sa place, mais lentement, et après une longue et confuse agitation.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE QUATRIÈME (1731-1732)
Résumé
Jean-Jacques décide d’attendre Mme de Warens à Annecy. Il rencontre Melle Galley et Melle de Graffenried avec lesquelles il vit un épisode romantique mais platonique. En juillet 1730, il part vers Genève, Fribourg puis Lausanne où il revoit son père. Imitant un ami (Venture) rencontré précédemment, il se fait passer pour compositeur, bien que ses notions de solfège soient très sommaires. Mais il ne trompe personne. Il décide alors d’enseigner la musique, principalement à des demoiselles et il apprend en enseignant (comme la plupart des enseignants !). En 1731, il rencontre un archimandrite grec parlant mal le français auquel il va servir d’interprète et de secrétaire : il est de nouveau sur les chemins du côté de Fribourg et Berne. Ayant quitté l’archimandrite, il part pour Paris dans l’espoir d’y retrouver Mme de Warens, mais il apprend en arrivant dans la capitale qu’elle est repartie. Il se dirige alors vers Lyon et demande des informations à Mme du Chatelet, mais en vain. Il vit très difficilement à Lyon (misère, faim) et en septembre 1731 reçoit des nouvelles de Mme de Warens qui lui demande de la rejoindre à Chambéry. « Maman » lui obtient un emploi de secrétaire au cadastre.
___________________________________________________________________________________________________________
L’imagination prodigieuse de Jean-Jacques
Combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avais ! La décoration extérieure que j'avais vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l'alignement des maisons me faisaient chercher, à Paris, autre chose encore. Je m'étais figuré une ville aussi belle que grande, de l'aspect le plus imposant, où l'on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d'or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d'abord à tel point, que tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n'a pu détruire cette première impression, et qu'il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j'y ai vécu dans la suite ne fut employé qu'à y chercher des ressources pour me mettre en état d'en vivre éloigné. Tel est le fruit d'une imagination trop active, qui exagère par-dessus l'exagération des hommes, et voit toujours plus que ce qu'on lui dit. On m'avait tant vanté Paris, que je me l'étais figuré comme l'ancienne Babylone, dont je trouverais peut-être autant à rabattre, si je l'avais vue, du portrait que je m'en suis fait. La même chose m'arriva à l'Opéra, où je me pressai d'aller le lendemain de mon arrivée ; la même chose m'arriva dans la suite à Versailles ; dans la suite encore en voyant la mer ; et la même chose m'arrivera toujours en voyant des spectacles qu'on m'aura trop annoncés : car il est impossible aux hommes et difficile à la nature elle-même de passer en richesse mon imagination.
Les français : légers et volages
Il faut pourtant rendre justice aux Français : ils ne s'épuisent point autant qu'on dit en protestations, et celles qu'ils font sont presque toujours sincères ; mais ils ont une manière de paraître s'intéresser à vous qui trompe plus que des paroles. Les gros compliments des Suisses n'en peuvent imposer qu'à des sots. Les manières des Français sont plus séduisantes en cela même qu'elles sont plus simples : on croirait qu'ils ne vous disent pas tout ce qu'ils veulent faire, pour vous surprendre plus agréablement. Je dirai plus ; ils ne sont point faux dans leurs démonstrations ; ils sont naturellement officieux, humains, bienveillants, et même, quoi qu'on en dise, plus vrais qu'aucune autre nation : mais ils sont légers et volages. Ils ont en effet le sentiment qu'ils vous témoignent ; mais ce sentiment s'en va comme il est venu. En vous parlant ils sont pleins de vous ; ne vous voient-ils plus, ils vous oublient. Rien n'est permanent dans leur cœur : tout est chez eux l'œuvre du moment.
Jean-Jacques, employé au cadastre, devient professeur de musique
Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois : je passai là pour un bon maître, parce qu'il n'y en avait que de mauvais. Ne manquant pas, au reste, d'un certain goût de chant, favorisé d'ailleurs par mon âge et par ma figure, j'eus bientôt plus d'écolières qu'il ne m'en fallait pour remplacer ma paye de secrétaire.
Il est certain que pour l'agrément de la vie on ne pouvait passer plus rapidement d'une extrémité à l'autre. Au cadastre, occupé huit heures par jour du plus maussade travail, avec des gens encore plus maussades ; enfermé dans un triste bureau empuanti de l'haleine et de la sueur de tous ces manants, la plupart fort mal peignés et fort malpropres, je me sentais quelquefois accablé jusqu'au vertige par l'attention, l'odeur, la gêne et l'ennui. Au lieu de cela, me voilà tout à coup jeté parmi le beau monde, admis, recherché dans les meilleures maisons ; partout un accueil gracieux, caressant, un air de fête : d'aimables demoiselles bien parées m'attendent, me reçoivent avec empressement, je ne vois que des objets charmants, je ne sens que la rose et la fleur d'orange ; on chante, on cause, on rit, on s'amuse ; je ne sors de là que pour aller ailleurs en faire autant. On conviendra qu'à égalité dans les avantages, il n'y avait pas à balancer dans le choix. Aussi me trouvai-je si bien du mien, qu'il ne m'est arrivé jamais de m'en repentir ; et je ne m'en repens pas même en ce moment, où je pèse, au poids de la raison, les actions de ma vie, et où je suis délivré des motifs peu sensés qui m'ont entraîné.
Voilà presque l'unique fois qu'en n'écoutant que mes penchants je n'ai pas vu tromper mon attente. L'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile des habitants du pays me rendit le commerce du monde aimable ; et le goût que j'y pris alors m'a bien prouvé que si je n'aime pas à vivre parmi les hommes, c'est moins ma faute que la leur.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE CINQUIÈME (1732-1736)
Résumé
Gagnant désormais sa vie, Jean-Jacques continue à vivre auprès de Mme de Warens et de son valet-secrétaire, Claude Anet. « Maman » (Mme de Warens) devient sa maîtresse. Mais il apprend qu’elle entretient également en toute discrétion une relation avec Claude Anet. Rousseau a du respect pour Anet qui est quelqu’un de sérieux et de fiable. Le ménage à trois s’installe. Jean-Jacques se cultive, lit, apprend plus sérieusement la musique et donne même des petits concerts. Mais Claude Anet meurt. C’est lui qui, en réalité, introduisait un peu de discipline et de sérieux dans la gestion de la maison. Mme de Warens, bien que femme d’affaires, est une piètre gestionnaire et des problèmes financiers surgissent, que Rousseau est incapable de traiter correctement, malgré sa bonne volonté. Rousseau tombe malade et Mme de Warens s’occupe de lui. Son état s’améliorant, les deux amants décident de louer une maison à la campagne. Le séjour aux Charmettes commence.
_______________________________________________________________________________________________________
« Maman » devient maîtresse
La longue habitude de vivre ensemble et d'y vivre innocemment, loin d'affaiblir mes sentiments pour elle, les avait renforcés, mais leur avait en même temps donné une autre tournure qui les rendait plus affectueux, plus tendres peut-être, mais moins sensuels. A force de l'appeler maman, à force d'user avec elle de la familiarité d'un fils, je m'étais accoutumé à me regarder comme tel. Je crois que voilà la véritable cause du peu d'empressement que j'eus de la posséder, quoiqu'elle me fût si chère. Je me souviens très bien que mes premiers sentiments, sans être plus vifs, étaient plus voluptueux. A Annecy, j'étais dans l'ivresse ; à Chambéri, je n'y étais plus. Je l'aimais toujours aussi passionnément qu'il fût possible ; mais je l'aimais plus pour elle et moins pour moi, ou du moins je cherchais plus mon bonheur que mon plaisir auprès d'elle : elle était pour moi plus qu'une soeur, plus qu'une mère, plus qu'une amie, plus même qu'une maîtresse ; et c'était pour cela qu'elle n'était pas une maîtresse. Enfin, je l'aimais trop pour la convoiter : voilà ce qu'il y a de plus clair dans mes idées. Ce jour, plutôt redouté qu'attendu, vint enfin. Je promis tout, et je ne mentis pas. Mon coeur confirmait mes engagements sans en désirer le prix. Je l'obtins pourtant. Je me vis pour la première fois dans les bras d'une femme, et d'une femme que j'adorais. Fus-je heureux ? non, je goûtai le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en empoisonnait le charme : j'étais comme si j'avais commis un inceste. Deux ou trois fois, en la pressant avec transport dans mes bras, j'inondai son sein de mes larmes. Pour elle, elle n'était ni triste ni vive ; elle était caressante et tranquille. Comme elle était peu sensuelle et n'avait point recherché la volupté, elle n'en eut pas les délices et n'en a jamais eu les remords.
Jean-Jacques et les sciences expérimentales
Je voyais beaucoup aussi à Chambéri un jacobin, professeur de physique, bonhomme de moine dont j'ai oublié le nom, et qui faisait souvent de petites expériences qui m'amusaient extrêmement. Je voulus, à son exemple et aidé des Récréations mathématiques d'Ozanam, faire de l'encre de sympathie. Pour cet effet, après avoir rempli une bouteille plus qu'à demi de chaux vive, d'orpiment et d'eau, je la bouchai bien. L'effervescence commença presque à l'instant très violemment. Je courus à la bouteille pour la déboucher, mais je n'y fus pas à temps ; elle me sauta au visage comme une bombe. J'avalai de l'orpiment, de la chaux ; j'en faillis mourir. Je restai aveugle plus de six semaines ; et j'appris ainsi à ne pas me mêler de physique expérimentale sans en savoir les éléments.
« Maman » et Jean-Jacques
S'il y a dans la vie un sentiment délicieux, c'est celui que nous éprouvâmes d'être rendus l'un à l'autre. Notre attachement mutuel n'en augmenta pas, cela n'était pas possible ; mais il prit je ne sais quoi de plus intime, de plus touchant dans sa grande simplicité. Je devenais tout à fait son œuvre, tout à fait son enfant, et plus que si elle eût été ma vraie mère. Nous commençâmes, sans y songer, à ne plus nous séparer l'un de l'autre, à mettre en quelque sorte toute notre existence en commun ; et, sentant que réciproquement nous nous étions non seulement nécessaires, mais suffisants, nous nous accoutumâmes à ne plus penser à rien d'étranger à nous, à borner absolument notre bonheur et tous nos désirs à cette possession mutuelle et peut- être unique parmi les humains, qui n'était point, comme je l'ai dit, celle de l'amour, mais une possession plus essentielle, qui, sans tenir aux sens, au sexe, à l'âge, à la figure, tenait à tout ce par quoi l'on est soi, et qu'on ne peut perdre qu'en cessant d'être.
Rousseau et le style proustien
Profitant maintenant du dégoût que je lui trouvai pour la ville, je lui proposai de l'abandonner tout à fait, et de nous établir dans une solitude agréable, dans quelque petite maison assez éloignée pour dérouter les importuns. Elle l'eût fait, et ce parti que son bon ange et le mien me suggéraient nous eût vraisemblablement assuré des jours heureux et tranquilles jusqu'au moment où la mort devait nous séparer. Mais cet état n'était pas celui où nous étions appelés. Maman devait éprouver toutes les peines de l'indigence et du mal- être, après avoir passé sa vie dans l'abondance, pour la lui faire quitter avec moins de regret ; et moi, par un assemblage de maux de toute espèce, je devais être un jour en exemple à quiconque, inspiré du seul amour du bien public et de la justice, ose, fort de sa seule innocence, dire ouvertement la vérité aux hommes, sans s'étayer par des cabales, sans s'être fait des partis pour le protéger.
Les Charmettes
Après avoir un peu cherché, nous nous fixâmes aux Charmettes, une terre de M. de Conzié, à la porte de Chambéri, mais retirée et solitaire comme si l'on était à cent lieues. Entre deux coteaux assez élevés est un petit vallon nord et sud, au fond duquel coule une rigole entre des cailloux et des arbres. Le long de ce vallon, à mi-côte, sont quelques maisons éparses, fort agréables pour quiconque aime un asile un peu sauvage et retiré. Après avoir essayé deux ou trois fois de ces maisons, nous choisîmes enfin la plus jolie, appartenant à un gentilhomme qui était au service, appelé M. Noiret. La maison était très logeable. Au-devant était un jardin en terrasse, une vigne au-dessus, un verger au-dessous ; vis-à-vis un petit bois de châtaigniers, une fontaine à portée ; plus haut, dans la montagne, des prés pour l'entretien du bétail, enfin tout ce qu'il fallait pour le petit ménage champêtre que nous y voulions établir. Autant que je puis me rappeler les temps et les dates, nous en prîmes possession vers la fin de l'été de 1736. J'étais transporté le premier jour que nous y couchâmes. O maman ! dis-je à cette chère amie en l'embrassant et l'inondant de larmes d'attendrissement et de joie, ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici l'un avec l'autre, il ne les faut chercher nulle part.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
LIVRE SIXIÈME (1736)
Résumé
Malgré une santé fragile, Jean-Jacques trouve vraiment le bonheur aux Charmettes. Il hérite de sa mère et remet l’argent à Mme de Warens qui l’utilise pour l'envoyer se soigner à Montpellier. Au cours du voyage, il rencontre Mme de Larnage (beaucoup plus âgée que lui) avec laquelle il a une aventure. Il songe un instant à vivre avec elle mais décide finalement de rejoindre Mme de Warens. A l’arrivée à Chambéry, une surprise l’attend : il est supplanté chez Mme de Warens par un certain Wintzenried. Elle ne le chasse pas cependant, mais Jean-Jacques ne souhaite pas reprendre le ménage à trois et il accepte une place de précepteur à Lyon. La fonction ne lui convient pas et il l’abandonne rapidement. Revenu chez Mme de Warens, il met au point un nouveau (selon lui) système de notation musicale et part pour Paris le présenter à l’Académie.
Le bonheur aux Charmettes
Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Moments précieux et si regrettés ! ah ! recommencez pour moi votre aimable cours ; coulez plus lentement dans mon souvenir, s'il est possible, que vous ne fîtes réellement dans votre fugitive succession. Comment ferai-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si simple, pour redire toujours les mêmes choses, et n'ennuyer pas plus mes lecteurs en les répétant, que je ne m'ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse ? Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, je pourrais le décrire et le rendre en quelque façon ; mais comment dire ce qui n'était ni dit ni fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse énoncer d'autre objet de mon bonheur que ce sentiment même ? Je me levais avec le soleil, et j'étais heureux ; je me promenais, et j'étais heureux ; je voyais maman, et j'étais heureux ; je la quittais, et j'étais heureux ; je parcourais les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout : il n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même, il ne pouvait me quitter un seul instant.
L’autodidacte
Après une heure ou deux de causerie, j'allais à mes livres jusqu'au dîner. Je commençais par quelque livre de philosophie, comme la Logique de Port-Royal, l'Essai de Locke, Malebranche, Leibnitz, Descartes, etc. Je m'aperçus bientôt que tous ces auteurs étaient entre eux en contradiction presque perpétuelle, et je formai le chimérique projet de les accorder, qui me fatigua beaucoup et me fit perdre bien du temps. Je me brouillais la tête et je n'avançais point. Enfin, renonçant encore à cette méthode, j'en pris une infiniment meilleure, et à laquelle j'attribue tout le progrès que je puis avoir fait, malgré mon défaut de capacité ; car il est certain que j'en eus toujours fort peu pour l'étude. En lisant chaque auteur, je me fis une loi d'adopter et suivre toutes ses idées sans y mêler les miennes ni celles d'un autre, et sans jamais disputer avec lui. Je me dis : Commençons par me faire un magasin d'idées, vraies ou fausses, mais nettes, en attendant que ma tête en soit assez fournie pour pouvoir les comparer et choisir. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, je le sais ; mais elle m'a réussi dans l'objet de m'instruire. Au bout de quelques années passées à ne penser exactement que d'après autrui, sans réfléchir pour ainsi dire et presque sans raisonner, je me suis trouvé un assez grand fonds d'acquis pour me suffire à moi-même, et penser sans le secours d'autrui. Alors, quand les voyages et les affaires m'ont ôté les moyens de consulter les livres, je me suis amusé à repasser et comparer ce que j'avais lu, à peser chaque chose à la balance de la raison, et à juger quelquefois mes maîtres.
Le salut et la damnation : « n’insultez pas à ma misère car je vous jure que je la sens bien »
Je voudrais savoir s'il passe quelquefois dans les cœurs des autres hommes des puérilités pareilles à celles qui passent quelquefois dans le mien. Au milieu de mes études et d'une vie innocente autant qu'on la puisse mener, et malgré tout ce qu'on m'avait pu dire, la peur de l'enfer m'agitait encore souvent. Je me demandais : En quel état suis-je ? si je mourais à l'instant, serais-je damné ? Selon mes jansénistes la chose était indubitable ; mais selon ma conscience il me paraissait que non. Toujours craintif et flottant dans cette cruelle incertitude, j'avais recours, pour en sortir, aux expédients les plus risibles, et pour lesquels je ferais volontiers enfermer un homme si je lui en voyais faire autant. Un jour, rêvant à ce triste sujet, je m'exerçais machinalement à lancer des pierres contre les troncs des arbres, et cela avec mon adresse ordinaire, c'est-à-dire sans presque en toucher aucun. Tout au milieu de ce bel exercice, je m'avisai de m'en faire une espèce de pronostic pour calmer mon inquiétude. Je me dis : Je m'en vais jeter cette pierre contre l'arbre qui est vis- à-vis de moi ; si je le touche, signe de salut ; si je le manque, signe de damnation. Tout en disant ainsi, je jette ma pierre d'une main tremblante et avec un horrible battement de cœur, mais si heureusement qu'elle va frapper au beau milieu de l'arbre ; ce qui véritablement n'était pas difficile, car j'avais eu soin de le choisir fort gros et fort près. Depuis lors je n'ai plus douté de mon salut. Je ne sais, en me rappelant ce fait, si je dois rire ou gémir sur moi-même. Vous autres grands hommes, qui riez sûrement, félicitez- vous ; mais n'insultez pas à ma misère, car je vous jure que je la sens bien.
Conquête féminine
Nous avions laissé à Romans madame du Colombier et sa suite. Nous continuions notre route le plus lentement et le plus agréablement du monde, madame de Larnage, le marquis de Torignan, et moi. Le marquis, quoique malade et grondeur, était un assez bon homme, mais qui n'aimait pas trop à manger son pain à la fumée du rôti. Madame de Larnage cachait si peu le goût qu'elle avait pour moi, qu'il s'en aperçut plus tôt que moi-même ; et ses sarcasmes malins auraient dû me donner au moins la confiance que je n'osais prendre aux bontés de la dame, si, par un travers d’esprit dont moi seul étais capable, je ne m'étais imaginé qu'ils s'entendaient pour me persifler. Cette sotte idée acheva de me renverser la tête et me fit faire le plus plat personnage dans une situation où mon cœur, étant réellement pris, m'en pouvait dicter un assez brillant. Je ne conçois pas comment madame de Larnage ne se rebuta pas de ma maussaderie, et ne me congédia pas avec le dernier mépris. Mais c'était une femme d'esprit qui savait discerner son monde, et qui voyait bien qu'il y avait plus de bêtise que de tiédeur dans mes procédés.
Elle parvint enfin à se faire entendre, et ce ne fut pas sans peine. A Valence, nous étions arrivés pour dîner, et, selon notre louable coutume, nous y passâmes le reste du jour. Nous étions logés hors de la ville à Saint-Jacques ; je me souviendrai toujours de cette auberge, ainsi que de la chambre que madame de Larnage y occupait. Après le dîner elle voulut se promener : elle savait que le marquis n'était pas allant ; c'était le moyen de se ménager un tête-à-tête dont elle avait bien résolu de tirer parti, car il n'y avait plus de temps à perdre pour en avoir à mettre à profit. Nous nous promenions autour de la ville le long des fossés. Là je repris la longue histoire de mes complaintes, auxquelles elle répondait d'un ton si tendre, me pressant quelquefois contre son coeur le bras qu'elle tenait, qu'il fallait une stupidité pareille à la mienne pour m'empêcher de vérifier si elle parlait sérieusement. Ce qu'il y avait d'impayable était que j'étais moi-même excessivement ému. J'ai dit qu'elle était aimable : l'amour la rendait charmante ; il lui rendait tout l'éclat de la première jeunesse, et elle ménageait ses agaceries avec tant d'art, qu'elle aurait séduit un homme à l'épreuve. J'étais donc fort mal à mon aise, et toujours sur le point de m'émanciper ; mais la crainte d'offenser ou de déplaire, la frayeur plus grande encore d'être hué, sifflé, berné, de fournir une histoire à table et d'être complimenté sur mes entreprises par l'impitoyable marquis, me retinrent au point d'être indigné moi-même de ma sotte honte, et de ne la pouvoir vaincre en me la reprochant. J'étais au supplice : j'avais déjà quitté mes propos de Céladon, dont je sentais tout le ridicule en si beau chemin : ne sachant plus quelle contenance tenir ni que dire, je me taisais ; j'avais l'air boudeur, enfin je faisais tout ce qu'il fallait pour m'attirer le traitement que j'avais redouté. Heureusement madame de Larnage prit un parti plus humain. Elle interrompit brusquement ce silence en passant un bras autour de mon cou, et dans l'instant sa bouche parla trop clairement sur la mienne pour me laisser mon erreur. La crise ne pouvait se faire plus à propos. Je devins aimable. Il en était temps. Elle m'avait donné cette confiance dont le défaut m'a presque toujours empêché d'être moi. Je le fus alors. Jamais mes yeux, mes sens, mon cœur et ma bouche n'ont si bien parlé ; jamais je n'ai si pleinement réparé mes torts ; et si cette petite conquête avait coûté des soins à madame de Larnage, j'eus lieu de croire qu'elle n'y avait pas de regret. Quand je vivrais cent ans, je ne me rappellerais jamais sans plaisir le souvenir de cette charmante femme.
Les arènes de Nîmes au 18e siècle : « Les français n’ont soin de rien… »
A Nîmes, j'allai voir les Arènes : c'est un ouvrage beaucoup plus magnifique que le pont du Gard, et qui me fit beaucoup moins d'impression, soit que mon admiration se fût épuisée sur le premier objet, soit que la situation de l'autre au milieu d'une ville fût moins propre à l'exciter. Ce vaste et superbe cirque est entouré de vilaines petites maisons, et d'autres maisons plus petites et plus vilaines encore en remplissent l'arène ; de sorte que le tout ne produit qu'un effet disparate et confus, où le regret et l'indignation étouffent le plaisir et la surprise. J'ai vu depuis le cirque de Vérone, infiniment plus petit et moins beau que celui de Nîmes, mais entretenu et conservé avec toute la décence et la propreté possibles, et qui par cela même me fit une impression plus forte et plus agréable. Les Français n'ont soin de rien et ne respectent aucun monument. Ils sont tout feu pour entreprendre, et ne savent rien finir ni rien entretenir.
|
LES CONFESSIONS (1) : présentation et livres I à VI 7 pages |
LES CONFESSIONS (2) : livres VII à XII 6 pages |
Commentaires
-

- 1. karlo Le 19/09/2022
quel est l'objectif de ce texte?-
- rivagedebohemeLe 19/09/2022
Donner un aperçu de l'œuvre.
-

- 2. caillous Le 11/03/2020
merci sa m'a aider pour un dossier autobiographique
Ajouter un commentaire


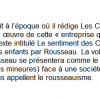
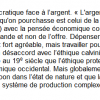
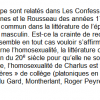



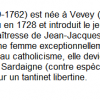





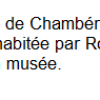







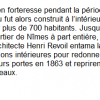
 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa